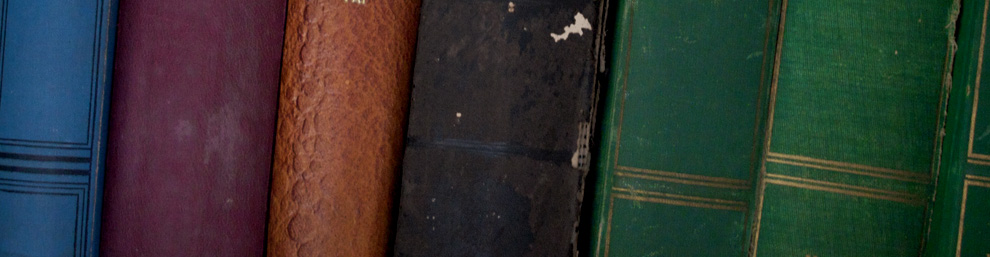Les écrits français sur le néochartalisme sont excessivement rares (surtout si on en soustrait ma production personnelle), mais un professeur a attiré mon attention sur un ancien article de deux professeurs d’économie français, Ludovic Desmedt et Pierre Piégay : Monnaie, État et Production : apports et limites de l’approche néo-chartaliste.1 C’est un article assez décevant : une vraie recherche bibliographique fut menée, mais passe à côté de l’essentiel au profit d’illusions déjà assez datées (voire en particulier le prochain billet de ce blog). Ils s’appuient beaucoup sur Michel Aglietta et André Orléan qu’ils citent abondamment. Leur effort mérite néanmoins d’être salué d’une réponse argumentée.
la capacité d’émission des banques secondaires se voit extrêmement minorée par le système de monnayage fiscal décrit.
Préservons-nous de la caricature. Les néochartalistes ont toujours intégré le crédit privé dans leurs analyses et reconnu son importance. Il n’existe parmi les auteurs cités, et on peut ajouter ma propre personne, aucun partisan du 100 % monnaie ou 100 % réserves, c’est-à-dire de l’interdiction (quasi-)complète du crédit privé. Warren Mosler se borne à vouloir laisser le taux d’intérêt à zéro, sans soutien de la banque centrale pour le remonter. Et il est le seul à aller aussi (peu) loin ! Concernant mon propre cas, le chapitre 4.2.3 de mon livre plaide en ma faveur sans ambiguïté.
Alors pourquoi les néochartalistes donnent cette impression de dédain concernant le crédit privé ? Parce que, dans ce tournoi idéologique entre monnaie publique et monnaie privée, l’importance de la monnaie privée est exagérée au point de la faire passer pour un parfait substitut (et même de qualité supérieure) à la monnaie publique qui n’a cessé d’être délégitimée depuis ces dernières quatre décennies environ. Du coup, pour les hétérodoxes que sont les néochartalistes, même s’ils croient fermement à l’importance du crédit privé (quoique moins qu’à celle de la monnaie publique), mieux vaut concentrer leurs forces limitées à expliquer et restaurer la monnaie publique plutôt qu’à s’époumoner sur le point de large accord concernant le crédit privé ; sinon, la spécificité de leur message risquerait de passer inaperçu. Il suffit de mettre un néochartaliste en face d’un partisan du 100 % monnaie (par exemple Milton Friedman en 1948) pour obtenir l’illusion d’optique symétriquement inverse.
On doit d’ailleurs noter que l’État peut parfois avoir une responsabilité directe dans l’effondrement du système monétaire qu’il cherche à unifier. Lorsque les agents doutent de la capacité de la puissance publique à gérer convenablement ses émissions de monnaie, ils vont rechercher un moyen alternatif de conserver leur pouvoir d’achat (ce peut être une conversion en or, mais aussi en toute autre marchandise susceptible d’être acceptée par le plus grand nombre). Dans ce domaine, l’État ne se trouve donc nullement investi d’une puissance incontestable. […]
Cela ne signifie pas pour autant qu’il initie la procédure. Le rôle d’un dictionnaire est clair : il entérine l’utilisation de mots intégrés à une langue depuis quelque temps.
Jamais les néochartalistes n’ont argumenté que l’État pouvait gérer n’importe comment sa monnaie et que cette dernière n’en subirait jamais la moindre conséquence. La ligne néochartaliste a toujours été que la contrainte pour l’État sont les ressources réelles (mais pas de contrainte financière), qu’une économie en croissance requiert des déficits publics quasi-continus, qu’il n’y aura jamais à rembourser cette dette publique (Au contraire. Pour le pseudo-problème des marchés dictant leurs conditions à la dette publique, cf cette série de billets.) et qu’une devise souveraine décemment gérée devient immanquablement hégémonique sur le territoire de cette souveraineté. Un simple constat empirique permet de réaliser qu’effectivement, la devise choisie par un État souverain devient, dans l’immense majorité des cas, la monnaie de son territoire, par exemple le dollar US aux États-Unis, le dollar canadien au Canada, le yen au Japon, le won en Corée du Sud, le dollar australien en Australie, le dollar néozélandais en Nouvelle-Zélande, etc. On aurait pu croire que le petit pays délaisserait spontanément sa devise pour une voisine accédant à un plus large marché, mais non. Dès qu’une communauté suffisamment constituée et auto-déterminée (c’est-à-dire souveraine) se choisit une monnaie, elle devient hégémonique en son sein. Il est en effet plus facile d’adosser une communauté à une monnaie en obtenant son soutien institué (État) que sans elle et surtout contre elle. De fait, même lorsqu’une devise est trop mal gérée, c’est dans l’immense majorité des cas de ces quelques exceptions une autre devise étatique qui est choisie par la plupart de la communauté. C’est si vrai que Milton Friedman le concédait en 1992, lui qui s’était alors fait le champion de la thèse de la nocivité de la monnaie publique et des vertus du crédit privé :
Il faut des taux d’inflation très graves — des taux à deux chiffres élevés persistant pendant des années — pour que le public cesse d’utiliser une monnaie qui se déprécie aussi ouvertement. Et, quand ils ont perdu leur foi en la fiction, les individus n’ont pas recours au troc : ils adoptent une autre monnaie. […] Qui plus est, il arrive que les gens ne délaissent pas totalement les billets : ils se tournent parfois vers une monnaie de papier dont l’émission n’a pas été excessive.
FRIEDMAN Milton, La monnaie et ses pièges, Dunod, Paris, 1993 (1992), 270 p., p. 26
Précisons pour finir que les 3 principaux cas où la devise souveraine ne s’impose pas sont :
- Elle est trop peu émise (forte déflation), et la communauté cherche à faire fonctionner une activité économique par d’autres moyens, consacrant la quasi-totalité de la devise souveraine au paiement de l’impôt. Elle est presque incapable de satisfaire son besoin d’épargne en cette devise.
- Elle trop émise (forte inflation), et la communauté n’a aucune difficulté à satisfaire à ses obligations fiscales, au contraire ; son défi est de stocker la valeur à travers le temps, en précipitant ses achats de biens réels, ou en investissant dans d’autres monnaies.
- Deux devises souveraines sont décemment gérées, mais certains individus se sont spécialisés dans le commerce entre les deux et subissent donc la pression fiscale des deux souverainetés : ils jonglent avec les deux devises sans qu’une des deux ne parvienne à hégémonie.
Notons que ce dernier cas peut être très important s’il s’agit d’un micro-État commerçant quasi-exclusivement avec un beaucoup plus puissant État-voisin, et disposant d’un marché intérieur négligeable (par exemple la devise du Vatican avec la devise choisie par l’Italie).
On peut dire que la monnaie a une nature autoréférentielle : est monnaie, ce que tout le monde considère être une monnaie. C’est ce qu’exprime la propriété d’autoréalisation (…) : ce qui compte, c’est l’unanimité.
J’éprouve toujours un léger sentiment d’étrangeté lorsque j’entends des débatteurs ranger le système fiscal, ainsi que tout le système judiciaire, policier et pénitencier utilisé ensuite en cas de non-paiement des impôts, ranger tout cela, dis-je, dans la catégorie « détails périphériques facilement contrés, trop légers pour être considérés » et simultanément ranger la tautologie de la monnaie acceptée comme monnaie parce qu’elle est acceptée comme monnaie dans la catégorie « facteur implacable, force déterminant toutes les autres qui sont négligeables devant elle ». Le premier serait futile : la preuve, dans quelques rares cas, la communauté choisit une autre monnaie que celle de son État ; la seconde serait primordiale : l’État est quand même très chanceux que l’unanimité de la communauté se fasse comme par hasard sur celle qu’il a choisie dans l’immense majorité des cas. Mieux encore, lorsque l’État souverain change de devise, l’unanimité se porte docilement sur cette nouvelle devise, comme lors du passage au nouveau franc, à l’euro, aux devises post-soviétiques, etc.
Ce modèle nous dit que la monnaie ne procède ni du contrat, ni de l’État […] en aucun cas, il ne faudrait, à la manière de Georg Friedrich Knapp, aller plus loin et faire de la monnaie un simple instrument aux mains de l’appareil étatique. L’insuffisance de l’État est apparente lorsqu’il cherche à restaurer artificiellement la confiance monétaire sans y parvenir : même la promesse de la guillotine n’arrêta en rien le rejet massif de l’assignat
Les néochartalistes se sentent confortés dans leurs analyses par la précédente citation, eux qui ont toujours clamé que c’était la fiscalité qui est la clé étatique de la monnaie, et non le cours légal ni le cours forcé. Remarquons au passage que les néochartalistes font alors une analyse beaucoup plus économique, voire utilitariste même, de la monnaie que ne veulent ici l’admettre leurs critiques qui les ramènent à de purs juristes croyant que la loi ferait tout toute seule. Certes non, mais elle permet l’impôt qui a la double propriété essentielle de conférer une valeur à la monnaie libérant de ces impôts, et de réguler la masse de cette monnaie au sein de l’économie en la retirant de la circulation. Arrivé ici, le problème redevient économique. Mais seulement à partir d’ici.
Les assignats furent émis excessivement, et c’est l'(hyper-)inflation qui les tuèrent. Que la quantité d’émission soit la clé du destin d’une devise (avec, bien sûr, les aléas du souverain émetteur lui-même) et non qu’elle soit devise publique plutôt que crédit privé, c’est ce que Desmedt et Piégay disent par ailleurs :
la prohibition des espèces illicites, de même que celle des espèces étrangères, était illusoire tant que la monnaie locale demeurait insuffisante en quantité. […] En Avril 1764 l’Acte sur la monnaie ou Currency Act étendit à l’ensemble des colonies continentales l’interdiction d’émettre des billets de banque, à compter du 1er septembre. (…) L’on affirmait ainsi à la face des colonies le rôle prépondérant de la monnaie anglaise, au risque d’asphyxier une économie qui souffrait d’une disette de son encaisse métallique
Ce qui compte, c’est l’émission raisonnable de la devise souveraine ; une fois cela assuré, elle devient vite hégémonique par la préférence que lui confère sa capacité à payer les obligatoires impôts.
Rapidement, sur le lien une nation-une monnaie. Il est possible d’être plus précis : une souveraineté-une monnaie. L’approximation une nation égale une souveraineté n’est pas absolument extravagante mais effectivement imparfaite.
Le lien entre État et monnaie se voit donc légitimement questionné. De nombreuses expériences monétaires récentes aiguisent la sagacité des analystes. C’est notamment le cas de […] la création de l’euro dont l’indépendance de l’institution de régulation vis-à-vis du pouvoir politique est statutairement forte.
Le contre-exemple donné de l’euro est particulièrement défavorable à la thèse d’une monnaie post-souveraineté, et qu’on sent là que l’article de Desmedt et Piégay date de 2007. Aujourd’hui, peu nombreux sont ceux qui vantent encore l’euro comme prouvant l’inutilité des États souverains, trésors publics en premier, dans la gestion d’une monnaie…
au milieu du XVe siècle (1442-72), pour financer ses guerres en Italie et en Orient, Venise fit frapper d’énormes quantités de monnaies noires destinées aux territoires de la Terreferme, monnaies que l’État lui-même refusait pour le paiement des droits et des impôts
Certes. Mais, qu’un système ne soit pas toujours mis complètement en place même s’il fonctionne remarquablement bien une fois en place, cela signifie-t-il que ce système soit faux ? Nullement. Quant à l’exemple donnée ailleurs de la Compagnie des Indes, il n’est pas nécessaire qu’elle soit l’ultime souverain pour pouvoir gérer la devise souveraine, une délégation de souveraineté peut suffire.
il apparaît que la production et la création des revenus précèdent les échanges et les autorise. […] Ainsi, nous devons considérer que le paiement des impôts suppose d’avoir obtenu un revenu préalablement
Exact. Et nous pouvons être encore plus précis : le paiement des impôts se faisant en la devise choisie par l’État, et l’État étant son seul émetteur par monopole légal (sinon, c’est là aussi puni par la loi comme faux-monnayage), ce revenu doit d’abord être une émission de devises par l’État. En pratique il s’agit d’un déficit public.
L’État peut néanmoins intervenir en tant que producteur. Lorsqu’il achète des biens et services, il dépense un revenu ; lorsqu’il produit les services collectifs estimés utiles socialement, il participe à la création des revenus.
De manière caractéristique, nous retrouvons ici une pensée de troc. Ressources réelles et ressources monétaires sont confondus, et la devise publique n’est plus qu’un ajout a posteriori. Ce que dénoncent pourtant les deux auteurs : « Cette démarche consiste à réintégrer a posteriori la monnaie dans l’analyse en supposant qu’elle ne modifie pas fondamentalement les mécanismes à l’œuvre. Se pose alors la question de la pertinence d’une analyse du fonctionnement du système économique qui ne fasse pas appel, dès l’origine, à la monnaie. »
[La banque centrale] demeure cependant essentielle au bon fonctionnement du système dans sa fonction de prêteur en dernier ressort.
Point significatif en passant, la crise des subprimes a illustré à maintes reprises que le prêteur en dernier ressort était finalement le trésor public et que la banque centrale préférait simplement avaliser la prise de risque politico-économique de son État en monétisant sa dette, et non directement celle de n’importe quelle banque même très en difficulté (justement parce que très en difficulté). Elle ne peut faire autrement, car elle ne peut détruire par défaut de paiement l’État qui la maintient en existence (monopole légal compris, mais aussi droit des contrats, etc.).
La création monétaire des banques est première et motrice ; la création de la monnaie centrale ou de la monnaie fiduciaire est seconde et induite.
Là réside certainement la racine du désaccord avec les deux auteurs. Rappelons que, contrairement à la devise publique qui acquiert de la valeur aussitôt que l’État décide de taxer en cette devise, le crédit privé nécessite d’être d’abord accepté par un tiers, d’être consenti par lui, pour pouvoir acquérir autant de valeur que le débiteur est capable d’honorer ce crédit comme promis (et la faillite n’est pas qu’une virtualité). Comme nous l’avons vu, pour peu que la devise souveraine soit bien gérée, tout le monde ou presque préfère fonctionner avec elle. Au contraire, le crédit privé, tentant par la facilité qu’il offre à chacun de payer selon ses souhaits, effraie par la perspective de n’être payé que selon la solvabilité du débiteur. Aussi le crédit est une paradoxale optimisation de la devise : plus on économise de ces devises par le crédit, plus la moindre petite insuffisance des devises pour solder ces crédits comme promis se traduit par un défaut de tous ces crédits, donc un défaut d’autant plus massif qu’il y avait de crédits. En résumé, avec le crédit, moins on utilise la devise, plus elle est indispensable.
Peut-elle être moteur ? À l’évidence non, et les banques centrales à travers le monde éreinte leurs taux directeurs jusqu’à zéro pour diminuer le besoin de déficits publics, tandis que les assouplissements quantitatifs ont prouvé maintes fois leur inefficacité, comme l’a démontré la BRI, mais aussi la Fed, et lors du prochain billet, la Banque d’Angleterre : le crédit privé est passif, quoique modulable par le taux directeur, et s’appuie sur la devise, vrai moteur financier de l’économie. D’ailleurs, il est pour le moins paradoxal que pour relancer le système financier il faille une recapitalisation d’urgence par le Trésor public, vilipendé d’habitude comme le poids mort de l’économie, et ce afin que le moteur cesse de caler…
La référence finale à Nicolas Oresme est ironique, car mon livre cite Mitchell-Innes, l’un des fondateurs du chartalisme, expliquant la désastreuse tentatives d’application des principes d’Oresme par le roi Charles V, pages 107-108.
Notes
1.
Publié dans les Cahiers d’économie politique, 2007/1 (n° 52), 206 p., p. 115-133, ISBN : 9782296036765. Version en ligne intégrale sur Cairn.